Orwellien
L’UE légalise l’arrestation des journalistes sans décision de justice préalable
Ursula von der Leyen a présenté vendredi la nouvelle loi européenne sur la liberté des médias comme une victoire pour leur pluralité et leur indépendance. Le règlement est en réalité une régression orwellienne. Il légalise l’espionnage ainsi que l’emprisonnement des journalistes et de leurs sources, sans qu’aucune décision de justice soit nécessaire.
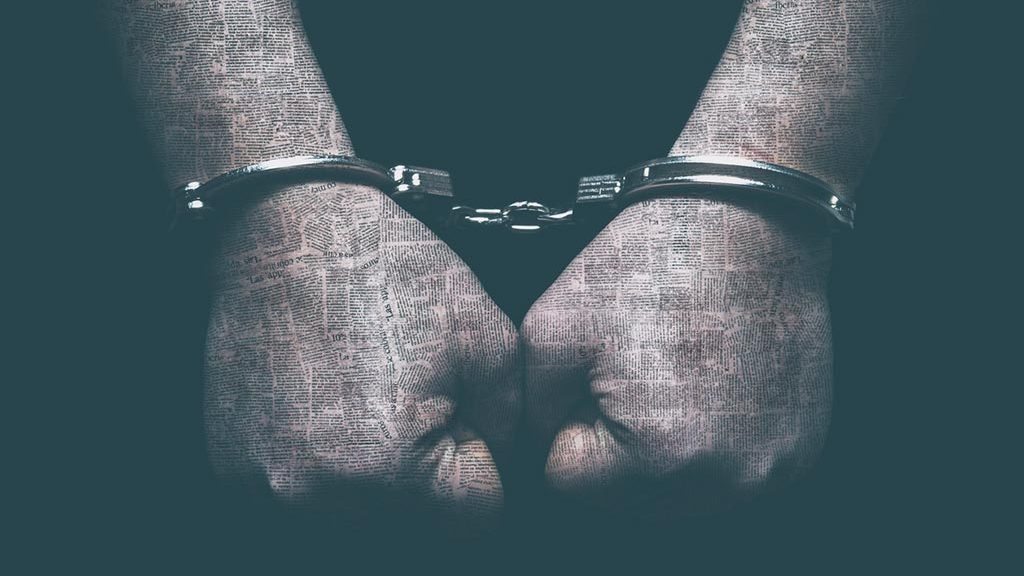
La loi européenne sur la liberté des médias (European Media Freedom Act) est entrée en vigueur le 8 août. Elle s’applique désormais à l’ensemble des États membres de l’UE. La nouvelle législation vise à renforcer la liberté et l’indépendance de la presse, présentée par la présidente de la Commission européenne comme « un pilier essentiel de notre démocratie ».
Le site de la Commission répertorie les neuf avancées que la loi est supposée représenter pour la liberté de la presse. Celles-ci incluent notamment la protection de l’indépendance éditoriale et des sources journalistiques, en particulier contre l’utilisation de logiciels espions. En pratique, le Règlement a conçu une série de mesures orwelliennes permettant d’atteindre ces objectifs.
Légalisation de l’espionnage, de l’emprisonnement et du fichage des journalistes
L’article 4 concerne la protection des sources, qu’il prétend renforcer en interdisant aux États d’obliger les rédactions ou leurs journalistes à les divulguer. L’alinéa 3 de l’article affirme qu’il sera dorénavant impossible pour un gouvernement de faire emprisonner ou d’espionner des journalistes, via l’utilisation d’un logiciel de surveillance intrusif, ou encore de perquisitionner leurs locaux afin qu’ils divulguent leurs sources. L’article 4 précise que les mêmes garanties sont offertes par le Règlement à leurs sources présumées.
L’alinéa 4 de l’article autorise toutefois une dérogation à ce cadre :
- si ces mesures sont prévues par le droit de l’Union ou le droit national – ce qui signifie qu’elles ne sont pas, par principe, illégales ;
- si elles sont conformes au § 52 de la Charte des droits de l’Union européenne qui encadre la restriction des droits et des libertés – en l’occurrence, si elles sont « nécessaires et répondant à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’UE » ;
- si elles sont « justifiée[s] au cas par cas par une raison impérieuse d’intérêt général ».
Le Règlement précise également que ces mesures d’emprisonnement ou d’espionnage pourront être appliquées sans autorisation préalable d’une autorité judiciaire ou d’une « autorité décisionnelle indépendante et impartiale ».
L’espionnage n’est par ailleurs autorisé qu’à des fins d’enquête, si une infraction répertoriée par l’UE (article 2 de la décision-cadre 2002/584/JAI) ou toute autre infraction grave, punissable d’une peine de trois ans d’emprisonnement de prison selon la législation nationale en vigueur, est suspectée. Les médias diffusant des contenus qui exposeraient les dangers présumés de la vaccination contre le COVID ou mentionneraient l’existence de traitements alternatifs, notamment en relayant des études (article 12 de la loi sur les dérives sectaires) relèvent donc potentiellement de ces mesures.
Il est également prévu de créer des listes nationales contenant le(s) dénomination(s) sociale(s) et les coordonnées des fournisseurs de services de médias (article 6). Le but est d’améliorer la transparence en matière de propriété des médias, officiellement pour prévenir le risque d’ingérence (§ 33 du préambule), mais ces bases de données permettront de faciliter les perquisitions et l’arrestation des journalistes supposés représenter une menace politique.
Création d’un Comité de surveillance piloté par la Commission afin de lutter contre la désinformation
La désinformation est ciblée par un seul article, mais elle est au cœur des objectifs du règlement. L’article 19 prévoit ainsi la mise en place d’un « dialogue structuré » entre la Commission et les plateformes en ligne afin de « surveiller [leur] adhésion aux initiatives d’autorégulation visant à protéger les utilisateurs des contenus préjudiciables, y compris la désinformation ainsi que les manipulations de l’information et les ingérences étrangères ». En d’autres termes, les médias devront s’assurer de façon autonome qu’aucun contenu « fallacieux » ou instrumentalisé par une entité étrangère ne fuite sur leur plateforme, mais ils devront se soumettre annuellement à un contrôle de leur adhésion à ce processus.
Des réunions annuelles entre la Commission et les acteurs du secteur des médias (plateformes Internet, rédactions de presse ou de TV, organisations de la société civile), ainsi que la création d’un comité ad hoc réputé « totalement indépendant » sont prévues à cet effet. Totalement indépendant signifie qu’« il ne devrait ni solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, d’aucune institution, qu’elle soit nationale, supranationale ou internationale, d’aucune personne publique ou privée ni d’aucun organisme public ou privé ».
Ce Comité européen pour les services de médias est institué en remplacement de l’actuel Groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) (article 8). Sa mission de conseiller la Commission européenne et de promouvoir la coopération entre les autorités réglementaires nationales.
La section 2 du Règlement détaille les attributions et le fonctionnement de ce Comité. Composé de représentants des autorités réglementaires nationales ainsi que d’un représentant de la Commission européenne, il pourra s’appuyer sur des « experts » et des « observateurs permanents ». Le Règlement ne précise pas quel sera leur pouvoir réel d’influence, mais leur présence est par définition incompatible avec l’interdiction de « solliciter des instructions » d’entités extérieures.
La Commission s’autoconfère par ailleurs l’autorité de gérer seule le secrétariat du Comité, dont la mission principale est de « contribuer à l’exécution en toute indépendance des tâches du comité ». Que signifie « indépendance » ? Indépendance vis-à-vis de qui ?
L’article 9 précise que « Le secrétariat agit sur les seules instructions du Comité », ce qui exclut théoriquement qu’il soit soumis à la Commission, mais le règlement lui offre deux voies pour contourner cette limite et influencer le travail de l’organe, via le Comité lui-même et son secrétariat.
Lutte contre le harcèlement des journalistes issus des médias « mainstream »
Le Règlement rappelle le droit fondamental des citoyens européens à accéder à des médias dits « de qualité », véhiculant une information « conforme », c’est-à-dire produite « par des journalistes de manière indépendante et conformément aux normes éthiques et journalistiques et qui fournissent par conséquent des informations fiables ». La Commission précise que cette exigence est tout particulièrement essentielle pour les contenus d’information et d’actualité, « qui comprennent une large catégorie de contenus revêtant un intérêt politique, sociétal ou culturel », et dont elle estime qu’ils « ont une incidence directe sur la participation démocratique et le bien-être de la société ».
Sur ce principe, la Commission se définit donc elle-même comme une autorité de censure des opinions politiques. Elle ne précise pas comment ou sur quels critères seront définis ces « médias de qualité », mais l’introduction de cette catégorie sémantique suppose un étiquetage, et donc un fichage politique des médias.
Enfin, le § 14 du préambule du Règlement contient une réflexion croustillante concernant le harcèlement dont seraient victimes les journalistes issus des médias dits « mainstream » :
Les services de médias de qualité représentent également un antidote contre la désinformation et la manipulation de l’information et l’ingérence étrangères. Il convient également de garantir l’accès à ces services en déjouant les tentatives de réduction au silence des journalistes, qui vont des menaces et du harcèlement à la censure en passant par la suppression d’opinions dissidentes, manœuvres qui pourraient limiter la libre circulation de l’information dans la sphère publique en réduisant la qualité et la pluralité de celle-ci.
La Commission fait probablement référence à la manière dont ont été moqués les journalistes qui ont affirmé à l’envi sur les réseaux sociaux que les injections anti-COVID étaient sûres et efficaces à 95 %. Si la première assertion survit dans l’inconscient collectif, la seconde s’est révélée si décalée par rapport à l’expérience de millions d’Européens, qu’elle a provoqué l’exode massif de ces faux journalistes et vérificateurs de faits, financés par les laboratoires pour désinformer la population, sur le réseau HelloQuitteX.
Grâce à ce Règlement, ils pourront à nouveau demain sévir en toute impunité dans l’espace public. La Commission leur déroule ici un tapis rouge.
